Pourquoi certains ministres clés ont-ils quitté l’Afghanistan ?
Les conflits internes des talibans ne portent pas sur les principes, mais sur le pouvoir

© Taliban

© Taliban
Ghulamullah Habibi & Ken Lambeets
28 avril 2025 • 13 Min de lecture
Des désaccords ouverts au sein des talibans révèlent des conflits internes, qui ont déjà poussé certains ministres talibans importants à quitter l'Afghanistan. Cependant, les experts soulignent que cela ne signifie pas que les talibans adopteront une approche plus modérée.
Cet article a été traduit du néerlandais par kompreno, qui propose un journalisme de qualité, sans distraction, en cinq langues. Partenaire du Prix européen de la presse, kompreno sélectionne les meilleurs articles de plus de 30 sources dans 15 pays européens.
Depuis le retrait des forces américaines et la prise de pouvoir par les talibans en 2021, l'Afghanistan est très isolé sur le plan international. Cet isolement s'est encore accentué depuis janvier dernier. La Cour pénale internationale de La Haye a alors émis des mandats d'arrêt à l'encontre du principal dirigeant taliban, Haibatullah Akhundzada, et du président de la Cour suprême afghane, le chef d'accusation étant crimes contre l'humanité. La raison en est la discrimination généralisée à l'égard des femmes et des jeunes filles, dont les droits ont été considérablement réduits.
Mais en Afghanistan même, les talibans ne contrôlent pas totalement la situation. Malgré les promesses de rétablir la sécurité dans le pays, des attentats ont encore lieu régulièrement. Ainsi, le mois dernier, un attentat suicide à Kaboul a fait un mort et trois blessés. L'auteur de l'attentat a été abattu par des agents de sécurité juste avant d'atteindre sa cible, le Ministère du développement urbain et du logement. L'attentat n'a encore été revendiqué par aucun groupe.
Par ailleurs, de nouveaux combats ont récemment eu lieu à la frontière afghano-pakistanaise. Un garde de sécurité afghan a été tué et deux autres ont été blessés. Quelques jours plus tard, des tirs de mortier pakistanais ont également blessé trois journalistes afghans. Le Pakistan a fermé la frontière le mois dernier en raison d'un différend concernant la construction d'un nouveau poste frontière afghan. Les combats ont bloqué à la frontière quelque 5 000 camions transportant des produits de première nécessité, aggravant ainsi la crise économique de l'Afghanistan.
Critique de l'interdiction de l'éducation des filles
Le fait que les talibans ne se trouvent pas dans une situation favorable, ressort également de plusieurs désaccords internes qui sont apparus de plus en plus souvent ces dernières semaines. Ainsi, Mohammad Abbas Stanikzai, ministre taliban des affaires étrangères par intérim, s'est réfugié aux Émirats arabes unis. Dans un discours prononcé dans la province de Khost fin janvier, il a critiqué l'interdiction de l'éducation des filles en Afghanistan. Il a souligné que les hommes et les femmes devaient avoir accès à l'éducation, en se référant à l'époque du prophète Mahomet.
À la suite de ces déclarations, le chef des talibans, Haibatullah Akhundzada, aurait ordonné à Stanikzai l'interdiction de voyager et son arrestation. Cette mesure aurait contraint Stanikzai à quitter l'Afghanistan. Bien que Stanikzai affirme s'être rendu à Dubaï pour des raisons de santé, son départ serait en fait lié à une arrestation imminente.
Lutte de pouvoir croissante
L'influent ministre de l'intérieur, Sirajuddin Haqqani, n'a pas non plus foulé le sol afghan depuis plus de 40 jours. Sirajuddin est le fils de Jalaluddin Haqqani, le fondateur et homonyme du réseau Haqqani. Il s'agit d'un groupe militant influent et notoire au sein des Talibans, qui entretient des liens étroits avec Al-Qaïda. Le réseau est tenu pour responsable d'une série d'attentats suicides contre des bâtiments gouvernementaux, des hôtels, des ambassades et des cibles militaires en Afghanistan et au Pakistan. Ces attentats ont fait des milliers de victimes, civiles et militaires.
Sirajuddin Haqqani aurait rencontré des responsables des Émirats arabes unis lors d'un séjour à Dubaï, avant de se rendre en Arabie saoudite pour l'umrah, le petit pèlerinage à La Mecque. Ce fait est remarquable, car certaines sources affirment que Haqqani aurait accompli le hajj – le pèlerinage à La Mecque – dès 2024. Cela laisse supposer que son second voyage ne serait pas exclusivement de nature religieuse.
Les talibans n'ont pas encore donné d'explication claire sur les récents voyages de Stanikzai et de Haqqani, ni sur les divisions croissantes. Bien que leur porte-parole reconnaisse les différences entre eux, il affirme qu'il n'y a pas de divisions ou de conflits internes. Pourtant, les critiques de plus en plus ouvertes au sein des talibans et l'absence prolongée de figures clés semblent indiquer une lutte de pouvoir croissante au sein du groupe.
MO* a demandé à trois experts leur avis sur l'évolution récente de la situation.
L'échec de la gouvernance talibane
Shahmahmood Miakhel, gouverneur de la province de Nangarhar puis ministre de la défense sous l'ancien président Ashraf Ghani, suit les événements dans son pays depuis les États-Unis. « Les talibans n'ont jamais été un mouvement homogène, » explique-t-il au téléphone. « Il faut plutôt voir les talibans comme un amalgame de différents groupes, dont le réseau Haqqani. Il existe également d'autres organisations extrémistes, comme Al-Qaïda, ISIS, le Mouvement islamique d'Ouzbékistan et le Tehreek-e-Taliban (TTP, les talibans pakistanais, ndlr). En outre, des gangs criminels et des cartels de drogue ont également joué un rôle dans la lutte contre l'ancien gouvernement afghan. Qu'est-ce qui les relie ? Le chaos qui leur a permis de gagner en influence et en ressources. »
Au sein même des talibans, Miakhel distingue trois factions principales : le groupe autour de Haibatullah Akhundzada dans la ville méridionale de Kandahar, le réseau Haqqani et les "négociateurs de Doha". Ces derniers sont les membres des Talibans qui ont organisé les pourparlers de paix entre le gouvernement afghan et les Talibans dans la capitale qatarie en 2020. « Les désaccords se multiplient entre ces factions, notamment en ce qui concerne l'orientation du régime et le degré d'ouverture au monde extérieur, » explique-t-il. « Ces désaccords sont de plus en plus ouverts. »
Miakhel critique également les échecs administratifs des talibans. Selon lui, au cours des quatre dernières années, l'organisation n'a rien fait de substantiel pour renforcer la légitimité de son régime, que ce soit au niveau national ou international. « Il n'y a eu aucun progrès en matière de gouvernance, de croissance économique ou de diplomatie internationale, » explique-t-il. « Le gouvernement taliban se trouve donc dans une position isolée, sans reconnaissance formelle et sans large soutien au sein même de l'Afghanistan, ni à l'extérieur. »
« Les talibans n'ont pas changé »
L'ancienne députée afghane Shukria Barakzai est carrément sceptique quant aux désaccords internes des talibans. Selon elle, ces soi-disant désaccords ne changent rien à leur politique. « Les ministres talibans partagent tous la même idéologie, » déclare-t-elle depuis Londres, où elle travaille comme journaliste.
« Les conflits internes ne portent pas sur des principes ou une idéologie, mais sur le pouvoir. »
Mme Barakzai parle en particulier d'Abbas Stanikzai, qui s'est réfugié à Dubaï. Elle doute de la sincérité de sa critique de l'interdiction de l'éducation des filles en Afghanistan. « Lors de son arrivée au pouvoir en 2021, Stanikzai a fait croire aux Afghans que les talibans auraient changé. Mais dans la pratique, nous n'avons rien vu de tel, » souligne-t-elle. Selon elle, non seulement Stanikzai, mais l'ensemble de la délégation de négociation a présenté une image trompeuse des talibans lors des pourparlers de paix de 2020, tant à la communauté internationale qu'au peuple afghan.
« Les conflits internes ne portent pas sur les principes ou l'idéologie, mais sur le pouvoir, » explique Mme Barakzai. « Qui obtient le plus d'autorité, le plus d'argent et les postes les plus importants ? Dès que certains membres se sentent lésés, ils commencent à critiquer. Mais cela ne change pas le fond du mouvement. »
La ligne idéologique devient plus convaincante
Selon Romain Malejacq, le chef taliban Haibatullah Akhundzada tente actuellement de renforcer son contrôle sur les talibans. Malejacq est professeur associé au Centre for International Conflict Analysis & Management (CICAM) de l'université Radboud de Nimègue, aux Pays-Bas, et auteur du livre Warlord Survival : the Delusion of State Building in Afghanistan (La survie des seigneurs de guerre : l'illusion de la construction d'un État en Afghanistan).
Selon lui, ce processus de centralisation entraîne des tensions, car il semble y avoir de moins en moins de place pour la dissidence. « La ligne idéologique du mouvement est désormais imposée de manière plus contraignante à ceux qui la critiquent, » affirme Malejacq, « ce qui explique le départ de Stanikzai à l'étranger. »
Mais les divisions internes au sein des talibans ne sont pas nouvelles. « Les tensions entre la faction Haqqani et les autres courants du mouvement existent depuis longtemps. Les talibans ont toujours essayé de ne pas faire de politique, car cela crée automatiquement des tensions. Maintenant qu'ils sont contraints de faire de la politique, les divisions internes font surface et deviennent plus visibles. »
(Continuez à lire ci-dessous les conseils de lecture)
Meer over de Taliban en Afghanistan
Une voie plus extrême
Le chef des talibans, Haibatullah Akhundzada, place de plus en plus ses propres confidents à des postes clés. Selon Malejacq, il agit ainsi pour renforcer son pouvoir et maintenir la cohésion. « Certains membres finissent en prison, d'autres disparaissent temporairement, comme nous l'avons déjà vu avec Abdul Ghani Baradar (l'un des fondateurs des talibans en 1994, ndlr). Nous ne savons pas exactement pourquoi des dirigeants comme Sirajuddin Haqqani ne se montrent pas en Afghanistan pendant de longues périodes, mais cela alimente les spéculations sur les tensions internes. »
L'universitaire souligne que les divisions internes ne signifient pas que les talibans relâcheront leur emprise sur le pays. « Au contraire, la crainte d'une désintégration pousse les talibans à adopter une attitude plus extrême. Plus la menace de division interne est grande, plus la politique de maintien de l'unité devient radicale. Certaines factions au sein des talibans estiment que le régime actuel ne va pas assez loin dans l'application de la loi islamique. Des groupes comme l'État islamique au Khorasan (ISKP) tentent de tirer parti de cette situation. »
Pas de concessions
Les Afghans sont les plus grandes dupes de cette lutte interne. « Si la fragmentation conduit à une évolution encore plus extrême, il est peu probable que le régime se modère, » affirme M. Malejacq. « La pression internationale semble avoir peu d'effet. De plus, les talibans ne sont pas disposés à faire des concessions à la communauté internationale, même en échange d'une aide humanitaire. »
L'universitaire a du mal à imaginer un scénario dans lequel les choses pourraient réellement changer en Afghanistan. « S'il devait y avoir un changement de pouvoir au sein des talibans, il pourrait y avoir de la place pour des dirigeants moins motivés par l'idéologie, » dit-il. « Cela pourrait conduire, par exemple, à des réformes limitées, telles que l'autorisation pour les filles et les femmes de travailler dans l'éducation. Mais tant que la structure actuelle du pouvoir reste intacte, les chances que cela se produise sont minces. »
Les femmes et les filles ne sont pas des êtres humains
Une militante des droits de la femme de Kaboul, qui souhaite rester anonyme pour des raisons de sécurité, brosse un tableau déchirant de la situation des femmes et des filles afghanes. Des millions de filles ne sont pas seulement exclues de l'éducation, elles sont à peine considérées comme des êtres humains par les talibans.
« Ce n'est pas seulement que les filles et les femmes n'ont pas le droit d'aller à l'école ou de travailler, » dit-elle dans un message audio, « dans ce système d'oppression, nous sommes rendues incapables de vivre. Malgré les luttes internes au sein des talibans, les Afghans restent les principales victimes du régime. Et la vie des femmes afghanes est de plus en plus désespérée. J'espère que la communauté internationale ne perdra pas cela de vue. »
Talibans contre Hayat Tahrir al-Sham
Matin Bek est chercheur au sein du Future Security Program de New America et a occupé des postes à responsabilité dans le précédent gouvernement afghan. Dans une analyse publiée sur The Cipher Brief, il écrit que les talibans ont manqué une occasion importante de se réformer et de conserver le soutien de la communauté internationale. M. Bek compare les talibans à Hayat Tahrir al-Sham (HTS) en Syrie, un groupe islamiste issu d'ISIS et d'Al-Qaïda qui a été condamné par de nombreux observateurs internationaux dans le passé et considéré comme une organisation terroriste.
Contrairement aux talibans, écrit M. Bek, le HTS a activement tenté d'améliorer sa propre image, de maintenir une société pluraliste en Syrie et de répondre aux préoccupations internationales en matière de sécurité. En conséquence, l'organisation gagne lentement en légitimité. « Avant la prise de contrôle, les Talibans venaient de créer un engagement diplomatique et une bonne volonté grâce à leur bureau de Doha, mais au cours des trois dernières années et demie, ils ont gaspillé cette position en institutionnalisant l'apartheid des sexes, aliénant à la fois les Afghans et la communauté internationale. »
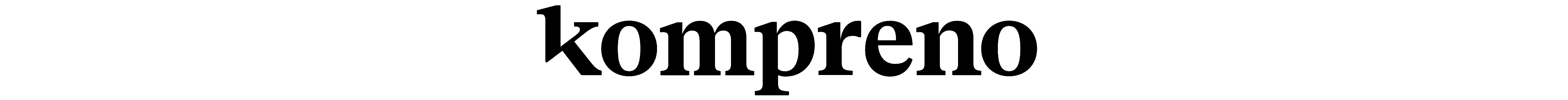 Cet article a été traduit du néerlandais par kompreno, qui propose un journalisme de qualité, sans distraction, en cinq langues. Partenaire du Prix européen de la presse, kompreno sélectionne les meilleurs articles de plus de 30 sources dans 15 pays européens.
Cet article a été traduit du néerlandais par kompreno, qui propose un journalisme de qualité, sans distraction, en cinq langues. Partenaire du Prix européen de la presse, kompreno sélectionne les meilleurs articles de plus de 30 sources dans 15 pays européens.
La traduction est assistée par l'IA. L'article original reste la version définitive. Malgré nos efforts d'exactitude, certaines nuances du texte original peuvent ne pas être entièrement restituées.
Si vous êtes proMO*...
La plupart de nos articles sont publiés en néerlandais et nous essayons d'en traduire de plus en plus. Vous pouvez toujours nous soutenir comme proMO* ou en faisant un don. Vous voulez en savoir plus ? Contactez-nous à l'adresse promo@mo.be.
Vous nous aidez à grandir et à nous assurer que nous pouvons répartir toutes nos histoires gratuitement. Vous recevez un magazine MO* et des éditions supplémentaires quatre fois par an.
Vous êtes accueillis gratuitement à nos événements et courez la chance de gagner des billets gratuits pour des concerts, des films, des festivals et des expositions.
Vous pouvez entrer dans un dialogue avec nos journalistes via un groupe Facebook séparé.
Chaque mois, vous recevez une newsletter avec un regard dans les coulisses.
Vous suivez les auteurs et les sujets qui vous intéressent et vous pouvez conserver les meilleurs articles pour plus tard.
Par mois
€4,60
Payer mensuellement par domiciliation.
Meest gekozen
Par an
€60
Payer chaque année par domiciliation.
Pour un an
€65
Payer pour un an.
Êtes-vous déjà proMO*
Puis connectez-vous ici