Sur l'engagement, l'activisme et l'ordre établi
La journaliste Fréderike Geerdink : «L’objectivité dans le journalisme est une illusion»

© Pixnio / Bicanski (CCO)

© Pixnio / Bicanski (CCO)
23 septembre 2025 • 15 Min de lecture
Dans son manifeste au titre quelque peu provocateur, All journalism is activism (2025), la journaliste néerlandaise Fréderike Geerdink brise le mythe du journalisme objectif et plaide résolument en faveur d'un plus grand engagement. Car le journalisme que nous connaissons aujourd'hui est trop lié au pouvoir. « Vous pouvez prendre le titre de mon livre au pied de la lettre : si ce n'est pas de l'activisme, ce n'est pas du journalisme".
Cet article a été traduit du néerlandais par kompreno, qui propose un journalisme de qualité, sans distraction, en cinq langues. Partenaire du Prix européen de la presse, kompreno sélectionne les meilleurs articles de plus de 30 sources dans 15 pays européens.
Fréderike Geerdink travaille dans le secteur depuis plus de 30 ans, mais elle a attiré l'attention en tant que correspondante indépendante en Turquie et au Kurdistan, où elle a également vécu pendant un certain temps avant d'être expulsée du pays par le président turc Recep Tayyip Erdoğan. Elle a écrit deux livres sur la lutte kurde : De jongens zijn dood (2014) et Dit vuur dooft nooit (2018), tous deux nominés pour le prix Brusse du meilleur livre journalistique en néerlandais décerné par le Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten in Nederland.
L'engagement dont elle a fait preuve dans ses reportages sur le peuple kurde lui a valu, outre une expulsion, d'être accusée d'être une journaliste activiste. Mme Geerdink a trouvé cette accusation étrange et injustifiée. Elle a cherché à comprendre pourquoi la rédaction avait agi de la sorte et est parvenue à des conclusions remarquables.
La première est que 95 % des journalistes sont blancs. Ils appartiennent donc au groupe dominant de la société, ce qui détermine littéralement leur vision de la réalité et donc la manière dont ils exercent leur profession. De plus, comme elle l'a appris en rédigeant son mémoire de maîtrise en journalisme international à l'université Napier d'Édimbourg, les journalistes blancs qui travaillent pour des médias établis se considèrent principalement comme des « chiens de garde non alignés ».
Cela signifie qu'ils n'ont aucun intérêt à couvrir l'actualité, si ce n'est de servir l'intérêt public avec des informations factuelles. Ce faisant, selon M. Geerdink, ils ignorent la perspective blanche qui prévaut dans le journalisme, la société et l'histoire. En d'autres termes, leurs reportages sont colorés. Car, écrit-elle, le blanc est aussi une couleur.
En Turquie, elle s'est rendu compte que, pour bien comprendre les problèmes locaux, elle devait regarder à travers les lunettes des Kurdes. Qu'elle devait les écouter, ainsi que d'autres groupes marginalisés, afin de refléter la réalité. Mme Geerdink a découvert qu'il ne s'agissait pas d'un « problème kurde », mais d'un « problème turc », où la majorité refuse de comprendre la position de la minorité.
Il en va de même aux Pays-Bas, où, par exemple, le racisme dans la société n'est toujours pas pris au sérieux. Mme Geerdink estime donc que le groupe dominant des journalistes blancs (principalement masculins) doit de toute urgence se regarder dans le miroir. Elle conseille au journalisme de regarder le pouvoir à travers les yeux de ceux qui n'ont pas de pouvoir.

La journaliste Fréderike Geerdink : « Dans la pratique, de nombreux journalistes établis soutiennent le pouvoir. Ils ont un angle mort complet en ce qui concerne leur propre position. »
© Fréderike Geerdink
L'objectivité est une illusion
Le journalisme devrait donner une voix à ceux qui n'en ont pas, mais ce n'est pas le cas. Est-ce cela qui vous a poussé à écrire votre manifeste ? Le fait que trop de journalisme soit devenu un porte-voix - un canal, comme vous l'appelez - plutôt qu'un questionnement ? Et encore moins un questionnement critique ?
Fréderike Geerdink : « Oui, mais je ne dirais pas tout de suite que les gens n'ont pas de voix. Tout le monde a une voix. C'est plutôt que toutes les voix ne sont pas entendues, ou qu'on ne leur met pas un micro sous le nez. Voilà la différence. »
« La formulation est toujours intéressante. Certains disent qu'il s'agit de personnes qui n'ont aucun pouvoir. Je préfère dire qu'il s'agit de personnes qui n'ont aucun pouvoir institutionnel. Si ces personnes s'unissaient, elles auraient tout simplement beaucoup de pouvoir. Mais cela ne fonctionne pas très bien parce que le capitalisme bloque le chemin et envoie les gens dans l'autre direction. »
« Dans la pratique, de nombreux journalistes établis soutiennent le pouvoir. Vous ne leur direz peut-être pas cela, car ils se considèrent comme très critiques, mais ils ont un angle mort complet en ce qui concerne leur propre position. Et cela me met très en colère. »
« Le journalisme est important pour une démocratie, mais aux Pays-Bas, il n'est pas à la hauteur de cette promesse parce qu'il est trop lié au pouvoir et qu'il appartient lui-même au groupe puissant et dominant de la société. Ces journalistes ne se rendent pas compte qu'ils ne remettent pas en question le pouvoir, mais qu'ils ne font que le renforcer. Et comme le journalisme est très important, je trouve cela très grave. »
Le journalisme est censé être objectif, mais vous dites que l'objectivité est une illusion. Pourquoi ?
Fréderike Geerdink : « Le mot objectivité ne figure même pas dans le code de déontologie du journalisme. Pas même dans le Code de Bordeaux sur lequel il est basé. (Le Code de Bordeaux est un code de déontologie considéré dans le monde entier comme une norme de comportement journalistique professionnel, élaboré en 1954 par la Fédération internationale des journalistes lors d'un congrès à Bordeaux, en France, ndlr). Je ne pense pas que le public le sache. Mon livre est là pour mes collègues, bien sûr, mais il reste principalement destiné au public. »
« Je reçois souvent des commentaires selon lesquels je ne serais pas objective, parce qu'après tout, c'est la valeur la plus élevée du journalisme. Mais les journalistes de 1954 savaient déjà que l'objectivité n'existe pas. Le journalisme est une affaire de faits et d'honnêteté. Et ce sont des choses différentes de l'objectivité. L'objectivité suggère que vous flottiez au-dessus de la société comme un robot qui enregistre de manière neutre et que vous ne fassiez en aucun cas partie de l'histoire. Je pense qu'un grand nombre de journalistes établis se considèrent également comme tels et je trouve cela tout à fait stupéfiant. »
« Ils pensent qu'il faut garder une distance professionnelle. Mais en tant que journaliste palestinien, comment garder ses distances par rapport aux informations sur la Palestine ? Des femmes ont à nouveau été tuées aux Pays-Bas. Devrions-nous, en tant que femmes journalistes, faire des reportages à distance ? Non, il s'agit de nous, n'est-ce pas ? Nous sommes en train d’être assassinées. »
« Je suis impliquée dans mon travail, dans les sujets sur lesquels j'écris. Pourquoi ne pourriez-vous pas être impliqué ? Si je fais un reportage sur les Kurdes, un groupe de population que je connais bien, je suis considéré comme trop impliqué. Mais c'est de l'expertise. C'est aussi de l'implication, bien sûr, mais cela ne nuit pas à mon expertise et à l'honnêteté de mes reportages. Je reste un journaliste professionnel. »
Stylo, papier et enregistreur
Cette obsession de l'objectivité s'explique-t-elle par la crainte d'être qualifié d'activiste ? Car c'est un gros mot pour un journaliste.
Fréderike Geerdink : « Tout à fait. Aux Pays-Bas, l’activisme est également presque un gros mot. Un activiste bouscule l'ordre établi et cela est interdit. »
« Vous pouvez prendre le titre de mon livre au pied de la lettre. Et j’y ajoute que si ce n'est pas de l'activisme, ce n'est pas du journalisme. Si un journaliste local écrit sur un carrefour dangereux, où des enfants sont renversés à vélo, il ne le fait pas pour donner du pouvoir. Il ne dit pas aux automobilistes qu'il s'agit d'un bon carrefour pour renverser les gens, mais qu'il pense que les enfants devraient pouvoir rouler en toute sécurité d'un point A à un point B. Il oblige alors la municipalité à faire quelque chose pour ce carrefour. »
« C'est faire preuve d'engagement dans l'intérêt public. Pas dans l'intérêt de l'automobiliste, du constructeur de routes ou de je ne sais qui. Vous voulez obtenir quelque chose dans l'intérêt public, et c'est aussi ce que font les activistes. »
MO*, par exemple, publie parfois des articles rédigés par des scientifiques et des militants, ou des scientifiques militants, mais il ne s'agit pas de journalistes professionnels. Selon vous, existe-t-il une limite ou une ligne de démarcation ?
Fréderike Geerdink : « Je m'identifie très clairement en tant que journaliste et non en tant qu'activiste. Les activistes ont d'autres méthodes. Cela m'est apparu très clairement au Kurdistan. J'y ai travaillé parce que j'estimais que la question kurde nécessitait plus d'attention et une explication claire de la part des personnes concernées. Mais je me suis toujours tenu là avec un stylo, du papier et un appareil d'enregistrement, et non avec des banderoles et des slogans. C'est une méthodologie différente. Avec mon journalisme, je veux obtenir quelque chose dans l'intérêt public. C'est donc de l'activisme. Je veux obtenir quelque chose. »
« Si un scientifique qui a quelque chose à dire publie dans un magazine, il appartient au média journalistique de vérifier si l'article a du sens et ne repose pas sur des mensonges. Un scientifique peut également se conformer au code de déontologie journalistique. »
Le chien de garde non aligné n'existe pas
Le journalisme est considéré comme le quatrième pouvoir. Mais si le journalisme fait essentiellement partie du pouvoir, qui a décidé que le journalisme était le quatrième pouvoir ?
Fréderike Geerdink : « C'est une excellente question. C'est nous qui l'avons posée, bien sûr. Mais ce n'est pas le cas. »
« La Turquie, et plus encore le Kurdistan, ont aiguisé mon regard. Les journalistes kurdes n'ont pas accès au pouvoir. S'ils défient le pouvoir, ils sont arrêtés, persécutés, emprisonnés ou doivent s'exiler. Et parfois, des journalistes kurdes sont assassinés. Ils n'ont donc aucun pouvoir institutionnel, mais ils s'acquittent très bien de leurs tâches journalistiques. »
« Il y a quelques années, un jeune Kurde a reçu une balle dans le dos lors du Nouvel An kurde à Diyarbakir (dans le sud-est de la Turquie, ndlr) parce qu'il portait une ceinture de bombes. Mais les Kurdes ne font pas ce genre de choses. Un photographe kurde se trouvait à proximité lorsque la police a demandé au garçon d'enlever sa chemise avant de tirer. Il ne portait pas du tout de ceinture explosive. C'était un étudiant du conservatoire qui voulait devenir violoniste. Nous le savons grâce au journalisme kurde, qui prend donc à cœur sa mission de quatrième force. »
« Dans les études universitaires que j'ai lues pour ma maîtrise, ces journalistes se définissent comme des défenseurs du changement social. C'est davantage le cas dans les pays à régime autoritaire comme la Turquie, mais aussi l'Égypte. On y trouve des journalistes qui soutiennent ouvertement le pouvoir et travaillent, par exemple, pour des médias directement contrôlés par le président. Mais il y a aussi des journalistes qui s'y opposent. Il y a très peu de journalistes qui s'identifient comme des chiens de garde non alignés, comme c'est le cas ici. Après tout, ils savent que cette position n'existe pas du tout. »
« Ici, aux Pays-Bas, lorsque des journalistes musulmans, noirs ou homosexuels veulent changer les perspectives sur leurs communautés, ils se retrouvent dans le journalisme établi et sont rejetés en tant qu'activistes pour les groupes marginalisés par les soi-disant chiens de garde non alignés. On leur demande ensuite d'être plus objectifs. »
« Le journalisme devrait remettre en question le pouvoir, et les personnes issues de groupes marginalisés connaissent très bien le pouvoir. Nous devons les écouter. Si nous avions écouté les journalistes de Gaza immédiatement après le 7 octobre, qui ont dit qu'un génocide était en cours, le journalisme aurait été mieux à même de remplir sa promesse. Et peut-être que nous ne serions pas dans ce trou à rats, avec des dizaines de morts chaque jour. Un génocide qui n'en finit pas. C'est vraiment une question de vie ou de mort là-bas. »
« Mais non, les journalistes du pouvoir établi blanc pensent qu'un tribunal devrait déterminer s'il s'agit d'un génocide. Alors que les journalistes de Gaza savent très bien ce qui leur arrive depuis 1948. »
Commercialisation des médias
Se pourrait-il que dans les années 1970 et 1980, le journalisme ait été moins lié aux piliers d'une part (parce qu'ils avaient perdu leur influence), mais aussi à la commercialisation, et qu'il ait ainsi mieux rempli sa mission de quatrième pouvoir ?
Fréderike Geerdink : « Le journalisme était peut-être plus critique parce que toute la société l'était aussi à l'époque. C'était une période de changement social, avec beaucoup de chômage dans les années 1980. »
« Mais, bien sûr, le journalisme a toujours été blanc et établi. De nombreux programmes ont été lancés dans les années 70 pour donner de la couleur aux rédacteurs en chef. Mais ils n'ont jamais abouti parce qu'il n'y a jamais eu de réflexion fondamentale sur la position du journalisme. Des journalistes issus de groupes marginalisés ont été recrutés, mais ils sont toujours partis parce qu'ils n'entraient pas dans le moule et qu'ils étaient considérés comme des activistes. Sinon, nous aurions déjà eu d'autres rédacteurs en chef. »
« Lorsque le lien entre la politique et les médias a disparu aux États-Unis, les journaux (comme ici, ndlr) ont dû chercher un nouveau modèle de revenus. Et ce modèle a été trouvé dans les abonnements et la publicité. Mais ce modèle ne pouvait réussir que s'il s'adressait à des gens qui avaient de l'argent et qui avaient leur mot à dire sur le plan politique : les hommes blancs de la classe moyenne et supérieure. Les femmes et les Afro-Américains étaient laissés pour compte. Ce type de journalisme a fini par être connu sous le nom de journalisme objectif, mais il était ancré dans un modèle de revenus capitaliste, où les politiciens et les personnes économiquement importantes avaient la parole. »
N'assiste-t-on pas aujourd'hui à un scénario similaire, tant en Belgique qu'aux Pays-Bas, avec DPG Media et Mediahuis, qui ont acquis une position de monopole grâce au soutien bienveillant du gouvernement ?
Fréderike Geerdink : « Absolument. Et ils n'y voient aucun problème, car leurs comités de rédaction ont tous des statuts éditoriaux. Ces grands conglomérats médiatiques affirment qu'avec de grands titres à succès, ils peuvent soutenir les petits. Mais le capitalisme ne cherche qu'à engloutir encore plus de choses et à les dépouiller. »
« Je suis bien sûr favorable à un statut de la rédaction parce qu'il sépare le département marketing du département rédactionnel. Mais en réalité, ce n'est rien de plus qu'une berceuse. »
« Car imaginez-vous que les journalistes de DPG Media ou de tout autre groupe deviennent réellement les militants du changement social. Qu'ils se rendent compte qu'ils soutiennent le pouvoir. Qu'ils prennent leur travail très au sérieux et fassent des reportages en se plaçant du point de vue des personnes marginalisées. Qu'ils affichent désormais en première page qu'un génocide est en cours à Gaza. Qu'ils ne reproduisent plus les mensonges de Netanyahou, mais qu'à chaque fois qu'ils le citent, ils ajoutent qu'il ment. Qu'ils écrivent sur les musulmans, les noirs, les femmes portant le foulard, les transgenres... alors la coopération entre le département marketing et les rédacteurs en chef exploserait, parce que les annonceurs diraient au marketing que les rédacteurs en chef prennent désormais des groupes comme Extinction Rebellion très au sérieux. Alors pourquoi voudraient-ils encore figurer dans ce magazine avec leurs marques de voitures ? Les gens qui ont de l'argent pensent alors que le magazine est devenu un magazine militant et annulent leur abonnement. C'est la réalité du capitalisme et elle est encore aggravée par la concentration des médias. »
Les médias indépendants doivent se débrouiller pour garder la tête hors de l'eau. Pour vous, quel serait l'écosystème idéal pour le journalisme indépendant ?
Fréderike Geerdink : « Burning down the patriarchy, baby. »
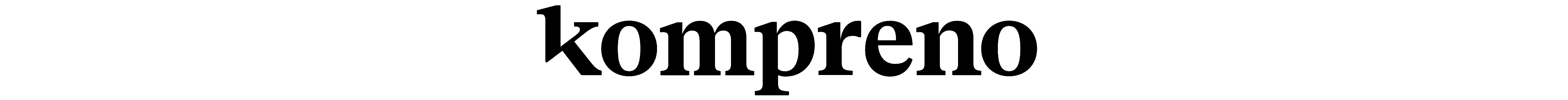 Cet article a été traduit du néerlandais par kompreno, qui propose un journalisme de qualité, sans distraction, en cinq langues. Partenaire du Prix européen de la presse, kompreno sélectionne les meilleurs articles de plus de 30 sources dans 15 pays européens.
Cet article a été traduit du néerlandais par kompreno, qui propose un journalisme de qualité, sans distraction, en cinq langues. Partenaire du Prix européen de la presse, kompreno sélectionne les meilleurs articles de plus de 30 sources dans 15 pays européens.
La traduction est assistée par l'IA. L'article original reste la version définitive. Malgré nos efforts d'exactitude, certaines nuances du texte original peuvent ne pas être entièrement restituées.
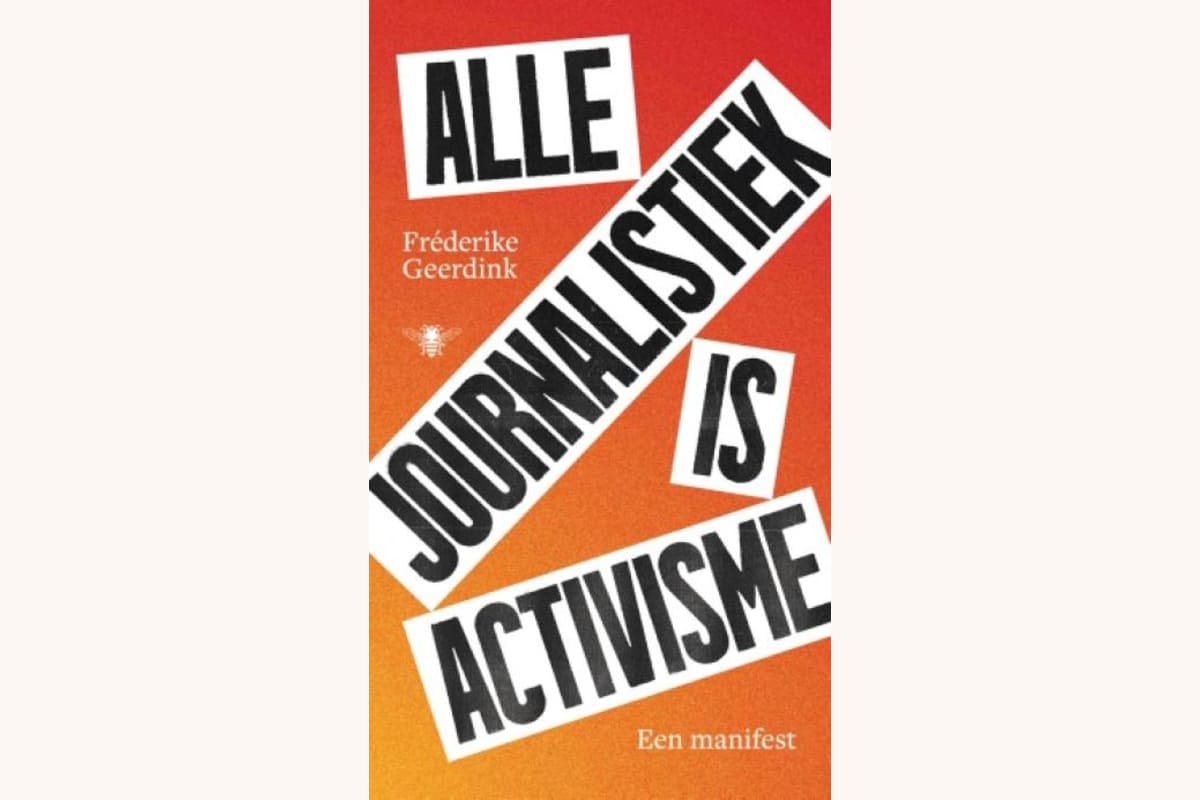
Alle journalistiek is activisme door Fréderike Geerdink is uitgegeven door De Bezige Bij. 123 blzn. ISBN 978 94 031 3557 1
Si vous êtes proMO*...
La plupart de nos articles sont publiés en néerlandais et nous essayons d'en traduire de plus en plus. Vous pouvez toujours nous soutenir comme proMO* ou en faisant un don. Vous voulez en savoir plus ? Contactez-nous à l'adresse promo@mo.be.
Vous nous aidez à grandir et à nous assurer que nous pouvons répartir toutes nos histoires gratuitement. Vous recevez un magazine MO* et des éditions supplémentaires quatre fois par an.
Vous êtes accueillis gratuitement à nos événements et courez la chance de gagner des billets gratuits pour des concerts, des films, des festivals et des expositions.
Vous pouvez entrer dans un dialogue avec nos journalistes via un groupe Facebook séparé.
Chaque mois, vous recevez une newsletter avec un regard dans les coulisses.
Vous suivez les auteurs et les sujets qui vous intéressent et vous pouvez conserver les meilleurs articles pour plus tard.
Par mois
€4,60
Payer mensuellement par domiciliation.
Meest gekozen
Par an
€60
Payer chaque année par domiciliation.
Pour un an
€65
Payer pour un an.
Êtes-vous déjà proMO*
Puis connectez-vous ici