En conversation avec Yosra Akasha, feministe et activiste
‘La violence sexuelle reste une arme de guerre au Soudan. Elle doit être traitée au niveau international’

© Yosra Akasha

© Yosra Akasha
La guerre au Soudan entame sa troisième année. Les dégâts sont énormes, les cicatrices profondes. Notamment à cause des violences sexuelles, qui sont une fois de plus utilisées comme tactique de guerre. ‘Les violences sexuelles reviennent sans cesse au Soudan parce que leurs auteurs s'en tirent à bon compte’, observe Yosra Akasha, féministe soudanaise et militante des droits de la femme.
Cet article a été traduit du néerlandais par kompreno, qui propose un journalisme de qualité, sans distraction, en cinq langues. Partenaire du Prix européen de la presse, kompreno sélectionne les meilleurs articles de plus de 30 sources dans 15 pays européens.
Lorsque Yosra Akasha a appris, deux jours à peine après le début de la guerre au Soudan, que des femmes avaient été violées à deux rues de chez elle, sa décision a vite été prise. Partir était la seule option. Trois jours plus tard, elle est arrivée avec des membres de sa famille à Nairobi, la capitale du Kenya.
‘Je vivais dans le centre de Khartoum. Quand on sait que des femmes ont été violées dans leur propre maison, on sait que les agresseurs sont allés dans les quartiers et ont envahi les maisons. Cela signifie que toutes les femmes sont visées et peuvent être victimes de violences sexuelles’.
Akasha, féministe et militante des droits de la femme, fait partie des 12 millions de Soudanais qui ont fui leur foyer depuis le déclenchement de la guerre civile en avril 2023, et des plus de 3 millions de réfugiés soudanais qui ont cherché refuge en dehors des frontières de leur pays. Elle fait partie des ‘privilégiés’. Elle a pu s'installer rapidement dans un autre pays et reprendre le fil de sa vie à partir de là.
« Lorsque des femmes et des filles sont violées, les hommes sont également pris pour cible. Cela signifie qu'ils ne valent rien, car ils ont abandonné les femmes et n'ont pas pu les protéger. »
Akasha considère sa fuite comme une conséquence directe des violences sexuelles. Cette violence est plus qu'un effet secondaire de la guerre ou un problème accessoire dans une situation de guerre, dit-elle. ‘La violence sexuelle est une arme de guerre. Elle humilie les communautés et pousse les gens à fuir. Lorsque des femmes et des filles sont violées, ce sont les hommes qui sont visés. Cela signifie que les hommes ne valent rien parce qu'ils ont abandonné les femmes et n'ont pas pu les protéger. Leur honneur est ainsi entaché’.
C'est la raison pour laquelle les factions en guerre prennent pour cible les femmes considérées comme appartenant à la communauté de ‘l'ennemi’. ‘Que ces femmes fassent effectivement ou hypothétiquement partie de la communauté de l'autre camp n'a pas d'importance’, sait Akasha. ‘C'est pourquoi, dans les guerres, les femmes d'une certaine classe, d'un certain clan ou d'une certaine ethnie sont prises pour cible. Le Soudan en est malheureusement un bon exemple.
Stigmatisation sociale et peur des représailles
La tactique de guerre qu'est la violence sexuelle est largement utilisée dans le conflit actuel au Soudan. Celui-ci a éclaté le 15 avril 2023 entre l'armée gouvernementale soudanaise (SAF) et les Forces de soutien rapide (RSF), le groupe paramilitaire dirigé par le tristement célèbre Mohamed Hamdan Dagalo, plus connu sous le nom d'Hemedti.
Plusieurs organisations ont déjà tiré la sonnette d'alarme et fait état de l'utilisation généralisée de la violence sexuelle. En novembre 2024, par exemple, Plan International a fait état d'une augmentation ‘significative’ des violences sexuelles à l'encontre des femmes et des filles au Soudan.
En décembre 2024, Human Rights Watch a fait état de viols collectifs et d'esclavage sexuel dans des zones où des personnes déplacées s'étaient installées, dans le Kordofan méridional. Tous ces crimes ont été commis par la Force de soutien rapide (RSF) et les milices alliées, écrit HRW dans son rapport.
“The world needs to recognize the magnitude of sexual violence in #Sudan and act quickly.”
— Human Rights Watch (@hrw) December 16, 2024
- @astroehlein in today's Daily Brief: https://t.co/M9C1odhSSt pic.twitter.com/PRClYFVO11
Même les enfants n'ont pas été épargnés. En mars dernier, l'Unicef a annoncé avoir recensé 221 viols d'enfants, dont 16 avaient moins de cinq ans et quatre moins d'un an. Selon l'organisation des Nations unies pour les droits de l'enfant, ces chiffres ne sont que la pointe de l'iceberg. Un tiers des cas recensés concernent des garçons, ce qui, selon l'Unicef, témoigne de l'ampleur des violences sexuelles déployées dans le cadre de cette guerre.
Chercher de l'aide n'est pas évident, surtout dans un pays comme le Soudan. ‘De nombreuses victimes ne signaleront jamais les violences sexuelles ou ne chercheront jamais à obtenir de l'aide par peur des représailles ou de la stigmatisation sociale liée à ce problème’, confirme Akasha.
Mais les chiffres ne sont pas le principal moyen d'attirer l'attention de l'opinion publique et des dirigeants politiques. Donner un visage aux victimes a plus d'impact. Cela peut susciter de l'empathie et encourager l'action, estime la militante des droits de la femme, qui est aussi une experte des médias. C'est pourquoi il est important d'apporter des témoignages de victimes. C'est le rôle des médias, explique Akasha.
Et c'est ce que font également les journalistes locaux. Dans une vidéo de Noon Post (voir ci-dessous), diffusée sur les médias sociaux en juin 2024, un journaliste soudanais raconte comment des filles d'une même famille, la plus âgée ayant dix-neuf ans et la plus jeune à peine treize ans, ont été violées dans leur propre maison, et comment leur mère n'a été autorisée à se montrer que pour apporter de la nourriture aux violeurs.
"كانت تقدم الغداء لمغتصبي بناتها".. إعلامي سوداني يحكي تفاصيل مروّعة عن حادثة اغتصاب لفتيات صغيرات على أيدي قوات الدعم السريع المدعومة إماراتيًا#السودان pic.twitter.com/g0UmCRlqtq
— نون بوست (@NoonPost) June 8, 2024
Ashwaq Saif, une journaliste soudanaise de la chaîne turque arabophone TRT, a également rapporté le témoignage d'une des victimes et a reçu beaucoup d'éloges à ce sujet sur les médias sociaux.
Cependant, Yosra Akasha critique la façon dont les médias locaux et sociaux traitent la question. Elle estime qu'ils sont trop souvent sensationnalistes et qu'ils diffusent parfois de fausses informations. Par exemple, l'histoire circule que des femmes se seraient suicidées en masse pour éviter d'autres violences sexuelles. Mais cette histoire est très difficile à vérifier.
De nombreuses atrocités ont été commises dans le centre de l'État de Gezira lorsque les forces de soutien rapide ont pris le contrôle de la région. Mais l'histoire du suicide collectif a plus à voir avec le passé du Soudan qu'avec la guerre actuelle, explique Akasha. Le fait que cette histoire ait été ravivée montre à quel point l'impact des violences sexuelles peut être important, non seulement sur l'individu, mais aussi sur l'ensemble de la société.
‘L'impact de la violence sexuelle ne s'arrête pas à la fin de la guerre, mais peut perdurer pendant des décennies’. Le suicide massif de femmes et de jeunes filles a eu lieu pendant le soulèvement du Mahdi, de 1881 à 1899, et l'histoire se répète encore et encore et est une source de fierté pour la société soudanaise jusqu'à aujourd'hui.
‘Bien que ces victimes n'aient peut-être pas su comment continuer à vivre au sein de leur propre famille après avoir été victimes de violences sexuelles, elles sont considérées par la société comme des héroïnes. Cela confirme l'idée que les femmes soudanaises sont de bonnes femmes, qui se protègent des viols et défendent leur honneur à tout prix. Cela se reflète dans le cinéma, par exemple, et maintenant aussi dans l'histoire du suicide collectif à Gezira, qui n'a pas pu être confirmée’.
L'impunité
‘La violence sexuelle à l'encontre des femmes et des jeunes filles est très répandue au Soudan et constitue depuis longtemps un problème majeur, non seulement en temps de guerre, mais aussi en temps de paix’, explique Yosra Akasha. ‘Le conflit au cours duquel les violences sexuelles ont reçu le plus d'attention est probablement la guerre au Darfour qui a débuté en 2003, car certains des crimes sexuels commis alors ont été documentés et considérés comme des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité’.
Pourtant, la condamnation des Nations unies n'a pas contribué à empêcher ces crimes. L'ironie est que les responsables des crimes sexuels commis à l'époque sont également tenus pour responsables des violences sexuelles commises dans le cadre de la guerre actuelle. Les Forces de soutien rapide (FSR) ne sont rien d'autre que les héritières des tristement célèbres milices Janjaweed. De ces deux groupes, Hemedti était et est toujours le chef militaire.
‘Les résolutions de l'ONU contre les violences sexuelles ne fonctionnent pas au Soudan parce qu'il n'y a pas de volonté politique de les mettre en œuvre.’
Mais Hemedti n'est pas le seul à avoir recours à ces tactiques de guerre, souligne Akasha. Il est vrai que les FAR sont responsables de la plupart des crimes commis aujourd'hui. Mais l'armée et les forces alliées sont également coupables de violences sexuelles, hier comme aujourd'hui, précise-t-elle.
Les violences sexuelles ont également été utilisées lors du soulèvement populaire qui a conduit à la chute du président Omar al-Bashir en 2019. Et les violences sexuelles ont également été utilisées plus tard, pendant la période de transition sous le contrôle du gouvernement de transition civilo-militaire qui était censé conduire le Soudan vers un système démocratique, lors des manifestations contre le coup d'État militaire du 25 octobre 2021. Les viols de manifestantes le 19 décembre 2021 sont les plus connus. ‘Les violences sexuelles ont été commises pour punir’, déclare la militante des droits de la femme.
‘Nous devons également nous rappeler que l'armée et l'Hemedti étaient alliées avant le coup d'État. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'il convient à l'armée de parler des crimes commis par RSF. C'est une tactique de guerre pour discréditer l'adversaire et maintenir le discours selon lequel l'armée est “le défenseur de la nation” et le “protecteur de l'honneur”’.
La résolution 1325
Ce n'est pas une coïncidence si les violences sexuelles au Soudan reviennent sans cesse et sont largement répandues. Elles reviennent parce que leurs auteurs s'en tirent à bon compte, estime Akasha. ‘Les organisations féministes et les organisations de défense des droits de l'homme ont tenté de faire pression sur le gouvernement de transition pour qu'il mette fin à l'impunité des violences sexuelles et soutienne les victimes. Malheureusement, le coup d'État a suivi et le conflit actuel n'a fait qu'aggraver la situation’.
Mais les violences sexuelles commises pendant la guerre au Darfour sont également restées impunies jusqu'à aujourd'hui, plus de 20 ans après, malgré les condamnations de l'ONU. Même si la résolution 1325 de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité appelle à accorder une plus grande attention aux femmes et aux filles dans la négociation et la mise en œuvre des accords de paix et à prendre des mesures contre les violences sexuelles, les résolutions de l'ONU contre les violences sexuelles ne sont pas appliquées.
‘Les résolutions de l'ONU contre les violences sexuelles ne fonctionnent pas au Soudan parce qu'il n'y a pas de volonté politique de les mettre en œuvre’, déclare Akasha.
‘Les militants soudanais ne peuvent pas changer cette situation à eux seuls. Il faut s'attaquer au problème au niveau international. C'est pourquoi l'ONU et ses États membres devraient revoir la résolution 1325 sur la protection des femmes dans les conflits armés et la renforcer par des mesures supplémentaires’.
Ce pourrait être un premier pas, estime la chercheuse-activiste. Il s'agirait d'éliminer la stigmatisation des victimes de violences sexuelles. Et cela pourrait permettre à la société soudanaise de transcender la question de l'honneur et de faciliter les poursuites judiciaires.
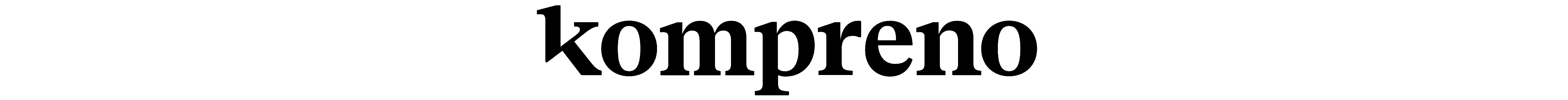 Cet article a été traduit du néerlandais par kompreno, qui propose un journalisme de qualité, sans distraction, en cinq langues. Partenaire du Prix européen de la presse, kompreno sélectionne les meilleurs articles de plus de 30 sources dans 15 pays européens.
Cet article a été traduit du néerlandais par kompreno, qui propose un journalisme de qualité, sans distraction, en cinq langues. Partenaire du Prix européen de la presse, kompreno sélectionne les meilleurs articles de plus de 30 sources dans 15 pays européens.
La traduction est assistée par l'IA. L'article original reste la version définitive. Malgré nos efforts d'exactitude, certaines nuances du texte original peuvent ne pas être entièrement restituées.
Lees meer over de oorlog in Soedan
Si vous êtes proMO*...
La plupart de nos articles sont publiés en néerlandais et nous essayons d'en traduire de plus en plus. Vous pouvez toujours nous soutenir comme proMO* ou en faisant un don. Vous voulez en savoir plus ? Contactez-nous à l'adresse promo@mo.be.
Vous nous aidez à grandir et à nous assurer que nous pouvons répartir toutes nos histoires gratuitement. Vous recevez un magazine MO* et des éditions supplémentaires quatre fois par an.
Vous êtes accueillis gratuitement à nos événements et courez la chance de gagner des billets gratuits pour des concerts, des films, des festivals et des expositions.
Vous pouvez entrer dans un dialogue avec nos journalistes via un groupe Facebook séparé.
Chaque mois, vous recevez une newsletter avec un regard dans les coulisses.
Vous suivez les auteurs et les sujets qui vous intéressent et vous pouvez conserver les meilleurs articles pour plus tard.
Par mois
€4,60
Payer mensuellement par domiciliation.
Meest gekozen
Par an
€60
Payer chaque année par domiciliation.
Pour un an
€65
Payer pour un an.
Êtes-vous déjà proMO*
Puis connectez-vous ici