Y a-t-il encore un avenir pour la médiation des conflits ?
Magnus Lundgren, politologue : « Les Nations unies ont en partie perdu leur rôle de médiateur dans les conflits, mais ce n'est peut-être pas si grave »

© Hugo Magalhaes / Pexels

© Hugo Magalhaes / Pexels
Kasper Nollet
22 avril 2025 • 13 Min de lecture
La médiation a longtemps été la solution standard pour les conflits internationaux, mais selon le politologue Magnus Lundgren, la médiation traditionnelle est aujourd’hui sous forte pression. En outre, dans cette époque de bouleversements géopolitiques, de nouveaux acteurs émergent, avec d'autres méthodes. « C’est une crise, mais l’histoire nous apprend qu’il y a toujours une solution. »
Cet article a été traduit du néerlandais par kompreno, qui propose un journalisme de qualité, sans distraction, en cinq langues. Partenaire du Prix européen de la presse, kompreno sélectionne les meilleurs articles de plus de 30 sources dans 15 pays européens.
Cet article a été publié pour la première fois en néerlandais le 5 avril 2025
Entre 1946 et 2015, une forme de médiation a été utilisée dans près de la moitié des guerres civiles et des conflits interétatiques. La pratique a connu un pic dans les années 1990. Selon le Center for Security Studies (CSS) de Zurich, il y a eu plus de processus de médiation à cette époque que pendant toute la guerre froide. C’est donc la méthode la plus utilisée pour gérer et résoudre les conflits.
Et pourtant, elle semble avoir perdu de sa force en tant qu’instrument de la politique internationale, comme le montrent les tentatives récentes de désescalade au Liban, à Gaza ou en Ukraine. Les équilibres géopolitiques sont en mutation, et l’émergence de nouveaux acteurs met également la méthode traditionnelle sous pression.
« La médiation est en crise », affirme le politologue Magnus Lundgren. Maître de conférences à l’université de Göteborg, il étudie depuis des années le fonctionnement et l’efficacité de la médiation. Il est spécialiste des organisations internationales, des conflits armés et des négociations multilatérales. Il a également mené des études de cas approfondies, notamment sur la guerre civile en Syrie.
« Le nombre de tentatives de médiation et de succès tangibles — comme des accords de paix ou des cessez-le-feu — a fortement diminué ces dix dernières années. Les percées récentes, comme certains cessez-le-feu temporaires au Moyen-Orient, constituent plutôt l’exception que la règle. »
Est-ce dû à la méthode de médiation elle-même ou au contexte géopolitique ?
Magnus Lundgren : « Les deux jouent un rôle. Sur le plan géopolitique, les tensions entre grandes puissances se sont intensifiées. Il y a moins de consensus sur qui doit jouer le rôle de médiateur. Les Nations unies, qui ont longtemps joué un rôle central, sont de plus en plus contestées. De plus, les conflits eux-mêmes sont devenus plus complexes : ils sont géographiquement étendus, impliquent une multitude de belligérants et ont souvent des ramifications religieuses, idéologiques et politiques. La guerre civile syrienne en est un bon exemple. »
Les médiateurs perdent-ils de vue les buts principaux?
Magnus Lundgren : « Exactement. Face à cette multitude d’acteurs, ils ont de plus en plus de mal à s’orienter. La nature des groupes combattants a elle aussi changé. On observe aujourd’hui une forte augmentation du nombre de groupes radicalisés et terroristes. Cela les place dans le viseur des politiques antiterroristes : ils sont surveillés de près, sanctionnés, et font l’objet d’opérations militaires. Cela complique énormément le travail des médiateurs. »
« Pour résister à ces opérations antiterroristes, des groupes comme le Hamas ont aussi commencé à s’organiser d’une manière très spécifique. Mais ils gardent cela confidentiel, et la hiérarchie structurée et la fragmentation des canaux de communication rendent le travail des médiateurs encore plus difficile. »
Que recouvre exactement la médiation dans les conflits ?
Magnus Lundgren : « Cela dépend de la nature du conflit. Le lieu, le contexte historique et les caractéristiques des parties en présence jouent un rôle, mais on peut identifier trois fonctions principales de la médiation. Premièrement, le médiateur facilite la communication entre des parties qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se parler directement, comme Israël et le Hamas, où un contact direct aurait un coût politique élevé — perte d’image, perte de crédibilité auprès de leur base, etc. Le médiateur offre alors un canal neutre. »
« Deuxièmement, les médiateurs peuvent proposer des accords. Ils analysent la situation et formulent des compromis réalistes. C’est le rôle classique du médiateur. »
« Enfin, les médiateurs peuvent exercer des pressions politiques. Parfois, les médiateurs eux-mêmes sont des acteurs politiques importants. À Gaza, on a vu les États-Unis faire pression sur Israël, tandis que l’Égypte et le Qatar faisaient de même auprès du Hamas. Cette pression est souvent cruciale pour débloquer une situation. »
« La médiation se fait souvent à huis clos, mais pas toujours. En Syrie, à un moment donné, un modèle hybride a été utilisé, combinant réunions secrètes et publiques. Cela n’a pas vraiment bien fonctionné là-bas, mais ailleurs, cela a parfois donné de bons résultats. »
Les leviers politiques sont-ils une condition préalable pour forcer un accord ?
Magnus Lundgren : « C'est tout à fait possible. Historiquement, les accords sont souvent le résultat d'une pression ferme. Les accords de Dayton, par exemple, qui ont mis fin à la guerre de Bosnie en 1995, ont été conclus grâce à la médiation américaine menée par Richard Holbrooke. Cette approche a été lourde, mais efficace. »
« La durabilité du cas bosniaque peut être débattue, mais au moins aucune autre guerre ouverte n'a eu lieu. Il n'en reste pas moins qu'il y a un risque. Dès que la pression retombe, le conflit peut reprendre. C'est ce qui s'est passé dans plusieurs pays africains. À Gaza aussi, on constate la fragilité d'une telle trêve. Les racines de ce conflit sont tout simplement trop profondes pour qu'il puisse être résolu uniquement par des pressions politiques. L'effet de levier est donc utile, mais il n'est souvent pas durable. Il produit parfois des accords fragiles. »
(L'interview continue après nos conseils de lecture)
Lees meer over conflictbemiddeling
Les Nations unies semblent perdre du terrain au profit des États-nations en tant que médiateurs. Cette évolution est-elle inquiétante ?
Magnus Lundgren : « En tant qu'ancien employé de l'ONU, j'ai tendance à défendre l'organisation. L'ONU est spéciale car c'est la seule organisation dont les membres viennent du monde entier. C'est particulièrement important pour les conflits entre États. L'ONU apporte principalement la légitimité, la transparence et la stabilité, ce qui est crucial pour une paix durable. »
« Je reconnais néanmoins ses limites. L'ONU est parfois lente, bureaucratique et vulnérable aux pressions politiques. Mais si les Nations unies ont perdu leur légitimité dans certains pays, elles la conservent dans une large mesure dans de nombreuses régions du monde. Il est donc important qu'elles continuent à jouer leur rôle, tout comme d'autres grandes organisations multilatérales devraient continuer à le faire. »
« D'autre part, l'émergence de nouveaux médiateurs montre également la capacité d'adaptation du système. Je ne parle pas nécessairement des États-Unis et d'autres grands pays. Ceux-ci seront toujours là et, d'ailleurs, ont toujours été là. Les ONG, les petits pays et les États émergents comme le Qatar jouent également un rôle croissant. Un système dans lequel de multiples acteurs peuvent jouer un rôle de médiateur ne me semble pas nécessairement mauvais. En principe, tant que l'objectif - la paix - est atteint, peu importe qui mène la médiation. Il suffit qu'elle soit perçue comme légitime. Il ne faut donc pas être trop pessimiste non plus. »
La perte de légitimité de l'ONU est-elle principalement un problème politique ?
Magnus Lundgren : « Absolument. L'ONU n'est pas tant confrontée à une inefficacité bureaucratique qu'à des blocages politiques. Au sein du Conseil de sécurité, les membres permanents tels que les Etats-Unis, la Chine et la Russie peuvent se contrecarrer les uns les autres grâce à leur droit de veto. Cette division rend l'action commune difficile. »
« Il y a des critiques légitimes à formuler à l'égard des Nations unies, que cela soit clair, mais elles disposent d'une expertise plus grande que jamais. Elles combinent leur grande capacité organisationnelle avec des décennies d'expérience et un vaste réseau d'acteurs locaux. »
« Le plus gros problème est en effet l'aspect politique des choses. Les membres du Conseil de sécurité ont plus d'intérêts que jamais dans les conflits actuels. En outre, ils ne parviennent tout simplement pas à se mettre d'accord sur le rôle que doit jouer l'ONU en termes de médiation. »
Les médias sociaux et la visibilité des conflits qui en découle ont-ils une incidence sur la médiation ?
Magnus Lundgren : « Certainement, même si peu de recherches ont été menées à ce sujet. Les médias sociaux rendent plus difficile la conduite de négociations secrètes, mais ils ne me semblent pas être un obstacle fondamental, ils offrent aussi des opportunités. Après tout, les médiateurs peuvent recueillir et diffuser des informations plus rapidement. C'est une arme à double tranchant. »
La médiation des conflits doit-elle changer fondamentalement pour être à l'épreuve du temps ?
Magnus Lundgren : « Au cours des dernières décennies, nous nous sommes habitués à ce que nous appelons dans ce domaine un "traitement standard" : une paix durable est négociée, les accords de paix - temporaires - qui en résultent sont appliqués par des forces de maintien de la paix, souvent originaires de différents pays, et l'aide au développement ainsi qu'un processus de justice transitionnelle complètent le tout. Cette formule standard fonctionne de moins en moins bien et il est clair qu'elle doit évoluer. »
« Cela peut signifier réformer les Nations unies, mais aussi donner un rôle plus important aux médiateurs locaux. Les ONG, les petits États et les organisations de la société civile peuvent mieux répondre à la fragmentation des conflits modernes. »
« Pourtant, je crois fermement que les méthodes et les moyens traditionnels ne sont pas encore épuisés. Réunir les partis, échanger des informations, proposer des accords et faire pression soi-même : ces ingrédients de base restent nécessaires. »
En ce qui concerne le maintien de la paix, les choses ne veulent plus vraiment se dérouler sans heurts.
Magnus Lundgren : « En effet. Le maintien de la paix est lui aussi en crise. Il n'y a pas eu de nouvelles missions de maintien de la paix de l'ONU depuis des années, et ce vide est en partie comblé par des groupes militaires privés. Le groupe controversé Wagner au Mali, par exemple, a été engagé par le gouvernement, mais il n'offre pas les mêmes avantages. Ces groupes semblent remplir le rôle habituel de l'ONU, mais n'y parviennent pas tout à fait. La question est alors de savoir comment procéder. »
« Les acteurs du maintien de la paix pourraient bien changer, mais il y a fondamentalement peu d'alternatives aux propriétés traditionnelles de la médiation. »
La complexité des conflits contemporains appelle-t-elle un style de négociation plus dur, comme celui de Donald Trump ?
Magnus Lundgren : « L'approche de Donald Trump - rapide, directe et sans conditions préalables - peut être efficace pour obtenir des résultats à court terme. Si vous ne vous occupez pas des violations des droits de l'homme, de la justice transitionnelle et de l'aide au développement, vous obtenez des résultats plus rapidement. Cette approche est alors "plus efficace" dans le sens où elle se concentre uniquement sur une sorte de transaction, sur un accord rapide. Mais cette approche apporte rarement des solutions durables. »
Dans votre travail sur la Syrie, vous avez souligné l'importance des rapports de force régionaux dans la médiation. Quelle est leur importance aujourd'hui ?
Magnus Lundgren : « Extrêmement importantes. La médiation fonctionne souvent mieux lorsque chaque partie a un allié solide à la table des négociations. Mon collègue Isak Svensson et moi-même avons pu le démontrer dans une étude réalisée en 2014. Il s'agit donc des deux parties d'un conflit. La pause temporaire dans les combats à Gaza il y a quelques semaines en est un bon exemple. Les États-Unis ont fait pression sur Israël, tandis que l'Égypte et le Qatar ont fait de même avec le Hamas. Ce type de "médiation en duo" augmente les chances d'une percée, même si elle n'est que temporaire dans ce cas. »
« Nous en avons également vu un exemple en Syrie. La Russie a soutenu le régime, tandis que les pays occidentaux ont soutenu l'opposition. Bien que le conflit n'ait pas été entièrement résolu, cette pression a permis d'aboutir à certains accords. »
« En principe, pour que le processus de paix en Ukraine soit efficace, les partenaires régionaux importants des deux parties devraient également être représentés au sein de l'équipe de médiation. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. »
Voyez-vous un moyen de sortir de l'impasse dans laquelle se trouve actuellement la médiation des conflits?
Magnus Lundgren : « Il est tentant d'être pessimiste. La montée des autocraties et des divisions géopolitiques complique la médiation. Les causes de la crise actuelle ne semblent donc pas disparaître. Le nombre de conflits et leur complexité ne diminuent pas. »
« Mais l'histoire montre que ces périodes ne sont pas permanentes. La guerre froide était une époque où la médiation n'était presque pas possible à cause de la rivalité bipolaire de la scène internationale. La guerre froide a été suivie d'une période de médiation intensive des conflits, lorsque les conditions géopolitiques étaient assez favorables. Cette période a duré près de vingt-cinq ans. La tendance actuelle à la baisse dure maintenant cinq à dix ans, mais cela ne veut pas dire qu'elle est permanente. »
« Les choses vont empirer avant de s'améliorer, mais grâce à l'innovation politique et organisationnelle, nous pouvons sortir de cette impasse. De nouveaux acteurs, de nouvelles technologies et de nouvelles approches façonneront l'avenir de la médiation des conflits. La motivation pour le faire est loin d'être perdue. Il y a donc certainement des raisons d'avoir un espoir modeste. »
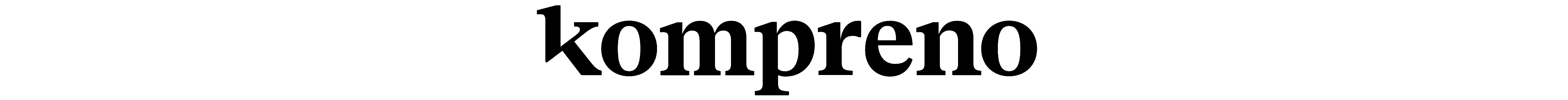 Cet article a été traduit du néerlandais par kompreno, qui propose un journalisme de qualité, sans distraction, en cinq langues. Partenaire du Prix européen de la presse, kompreno sélectionne les meilleurs articles de plus de 30 sources dans 15 pays européens.
Cet article a été traduit du néerlandais par kompreno, qui propose un journalisme de qualité, sans distraction, en cinq langues. Partenaire du Prix européen de la presse, kompreno sélectionne les meilleurs articles de plus de 30 sources dans 15 pays européens.
La traduction est assistée par l'IA. L'article original reste la version définitive. Malgré nos efforts d'exactitude, certaines nuances du texte original peuvent ne pas être entièrement restituées.
Si vous êtes proMO*...
La plupart de nos articles sont publiés en néerlandais et nous essayons d'en traduire de plus en plus. Vous pouvez toujours nous soutenir comme proMO* ou en faisant un don. Vous voulez en savoir plus ? Contactez-nous à l'adresse promo@mo.be.
Vous nous aidez à grandir et à nous assurer que nous pouvons répartir toutes nos histoires gratuitement. Vous recevez un magazine MO* et des éditions supplémentaires quatre fois par an.
Vous êtes accueillis gratuitement à nos événements et courez la chance de gagner des billets gratuits pour des concerts, des films, des festivals et des expositions.
Vous pouvez entrer dans un dialogue avec nos journalistes via un groupe Facebook séparé.
Chaque mois, vous recevez une newsletter avec un regard dans les coulisses.
Vous suivez les auteurs et les sujets qui vous intéressent et vous pouvez conserver les meilleurs articles pour plus tard.
Par mois
€4,60
Payer mensuellement par domiciliation.
Meest gekozen
Par an
€60
Payer chaque année par domiciliation.
Pour un an
€65
Payer pour un an.
Êtes-vous déjà proMO*
Puis connectez-vous ici